
Avant la mise en place du « choc des savoirs », certain·es collègues pouvaient témoigner spontanément qu’ils et elles avaient instauré une progression commune dans leur établissement et leur discipline, et en étaient satisfait·es. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Que met-on concrètement derrière cette notion de « progression commune » ? Des discussions approfondies, portant sur les détails du dispositif, de sa mise en œuvre et de ses implications concrètes, montrent que dans ces cas, il s’agit plutôt d’une mise en commun des progressions, sans imposition. Les collègues ont commencé par partager l’ordre (chronologique) dans lequel ils et elles abordaient les notions ou les chapitres. Cela leur a permis d’adopter ensuite un ordre commun, même si des variations ponctuelles sont fréquentes, par exemple lorsqu’un·e enseignant·e permute deux chapitres sur une dizaine ou une douzaine.
Les collègues se retrouvent une ou plusieurs fois dans l’année pour faire le point sur leur progression respective par rapport à la trame commune définie ensemble. Les différences de rythme ne posent pas de problème : qu’un·e collègue soit à un chapitre d’écart par rapport à un·e autre après quelques mois, ou que cet écart s’accentue en fin d’année, n’inquiète pas la plupart des équipes. L’objectif est d’avoir un nombre suffisant de chapitres en commun pour, par exemple, organiser un devoir commun. Il peut aussi s’agir de se mettre d’accord sur les éléments qui risquent de ne pas être traités, ou qui seront abordés de manière plus superficielle en fin d’année, à cause justement des rythmes d’avancement différents. Ces échanges permettent également de discuter des façons de travailler certains points du programme, ce qui est souvent apprécié.
Cette forme de progression commune peut parfois générer une pression pour celles et ceux qui avancent moins vite, mais les témoignages recueillis attestent majoritairement d’un vécu positif. Certain·es soulignent le caractère apaisé et collaboratif de ce mode de partage.
Synchroniser l’apprentissage d’élèves dans des groupes ou classes différentes ? Pourquoi ?
En revanche, ce sont des « progressions communes » bien différentes qui se sont imposées dans le cadre du « choc des savoirs » à l’initiative de directions ou de personnels d’inspection, notamment à l’occasion des formations destinées à préparer la rentrée 2024. Ici, la « progression commune » vise avant tout à permettre aux élèves de passer d’un groupe à un autre à différents moments de l’année. Quelques élèves pourraient ainsi changer de groupe, au prix d’une contrainte stricte de progression. C’est, pour ainsi dire, un indicateur de la mise en place de la réforme.
L’objectif étant différent, les modalités le sont également : il ne s’agit plus de partager une trame, mais de synchroniser précisément l’avancement, en empêchant tout écart de se creuser. Ce type de progression devrait être désigné autrement : il s’agit en réalité de « progressions synchrones ». Le terme « progression commune » a toutefois été utilisé dans le cadre du « choc des savoirs » pour adoucir la réalité. En reprenant un vocabulaire associé à des expériences positives, cette expression dissimule les exigences strictes de la progression synchrone. Certaines équipes de français se sont ainsi vues reprochées de ne pas parvenir à établir une « progression commune », alors que leurs collègues de mathématiques y parvenaient depuis longtemps. C’était une manipulation. Ce que faisaient leurs collègues de mathématiques depuis des années n’était plus ce qui était attendu désormais. En vérité, ce qui est demandé à tous et toutes n’est plus une progression partagée, mais bien une progression synchronisée, dissimulée sous une terminologie plus rassurante.
À la rentrée 2024, des collègues en mathématiques et en français ont rapidement signalé les dérives de ces progressions synchrones. Celles-ci imposent à chaque enseignant·e une charge accrue et une pression pour tenir le rythme imposé. Si l’un·e d’eux prend du retard, il ou elle doit ajuster sa progression pour rattraper le temps perdu, tandis que ses collègues doivent éventuellement ralentir pour maintenir l’alignement. Certaines équipes créent même des groupes sur les réseaux sociaux et échangent quasi quotidiennement sur leur état d’avancement, souvent le soir ou le week-end, pour gérer les écarts inévitables. Ceux-ci sont inévitables, notamment en raison du paradoxe initial : la création de groupes de besoin, censés répondre à des besoins différents, mais à une cadence unique.
Pour qui et pour quoi travaillons-nous ?
Ce « choc des savoirs », et son instigateur M. Attal, instaurent en 2024 une véritable prescription de cadence dans l’enseignement du français et des mathématiques en France, mais de manière pernicieuse, en faisant porter par les enseignant·es la charge de la conception et du respect de cette cadence. Or, il est impossible de maintenir une cadence rigide dans l’activité d’enseignement, travail vivant s’il en est. Vivant, car il ne se résume pas à des procédures figées : il nécessite des ajustements permanents pour s’adapter aux élèves et aux circonstances qui se découvrent. Vivant, parce que les personnes qui travaillent y investissent une part d’elles-mêmes. Et vivant, parce qu’il est tourné vers des êtres humains : nos élèves.
Être au même point de la progression le mardi 5 novembre, simplement pour être en phase avec les autres, se fait forcément au détriment de dimensions importantes de notre travail. Si un·e collègue est « en retard », c’est bien parce qu’il ou elle a fait autre chose. Et cette autre chose est souvent essentielle pour ses élèves.
Cette cadence imposée est incompatible avec le travail d’enseignement, avec nos métiers. Forcer les enseignant·es à suivre une cadence rigide revient à ignorer les spécificités de leur travail, au détriment des élèves, de leur propre équilibre, et même de leur santé.
L’objectif de cette synchronisation est-il d’améliorer les apprentissages des élèves ? Non. Il s’agit de maintenir l’illusion qu’un passage flexible d’un groupe à un autre est possible, soutenant ainsi une décision politique déconnectée de la réalité. Les effets de cette politique sur la santé psychique et morale des enseignant·es se font déjà sentir. Des collègues souffrent, des élèves en pâtissent, tout cela pour préserver la façade d’une mesure ministérielle prétendument fonctionnelle.
Être professeur·e de français ou de mathématiques en 2024, ce n’est pas tenir la cadence.


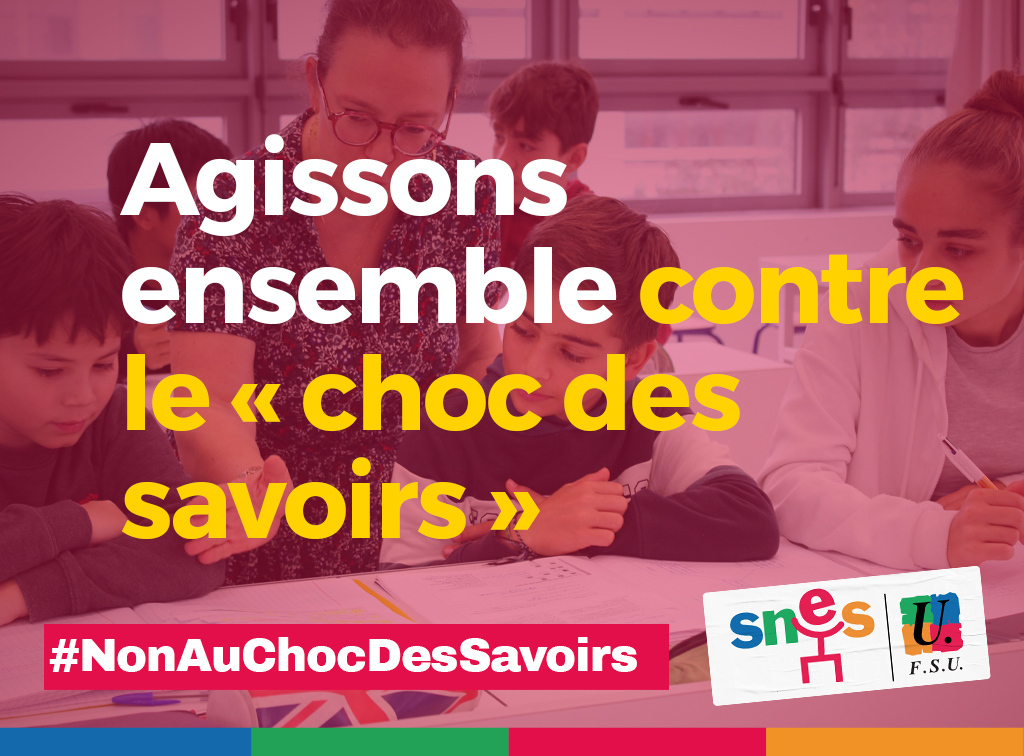


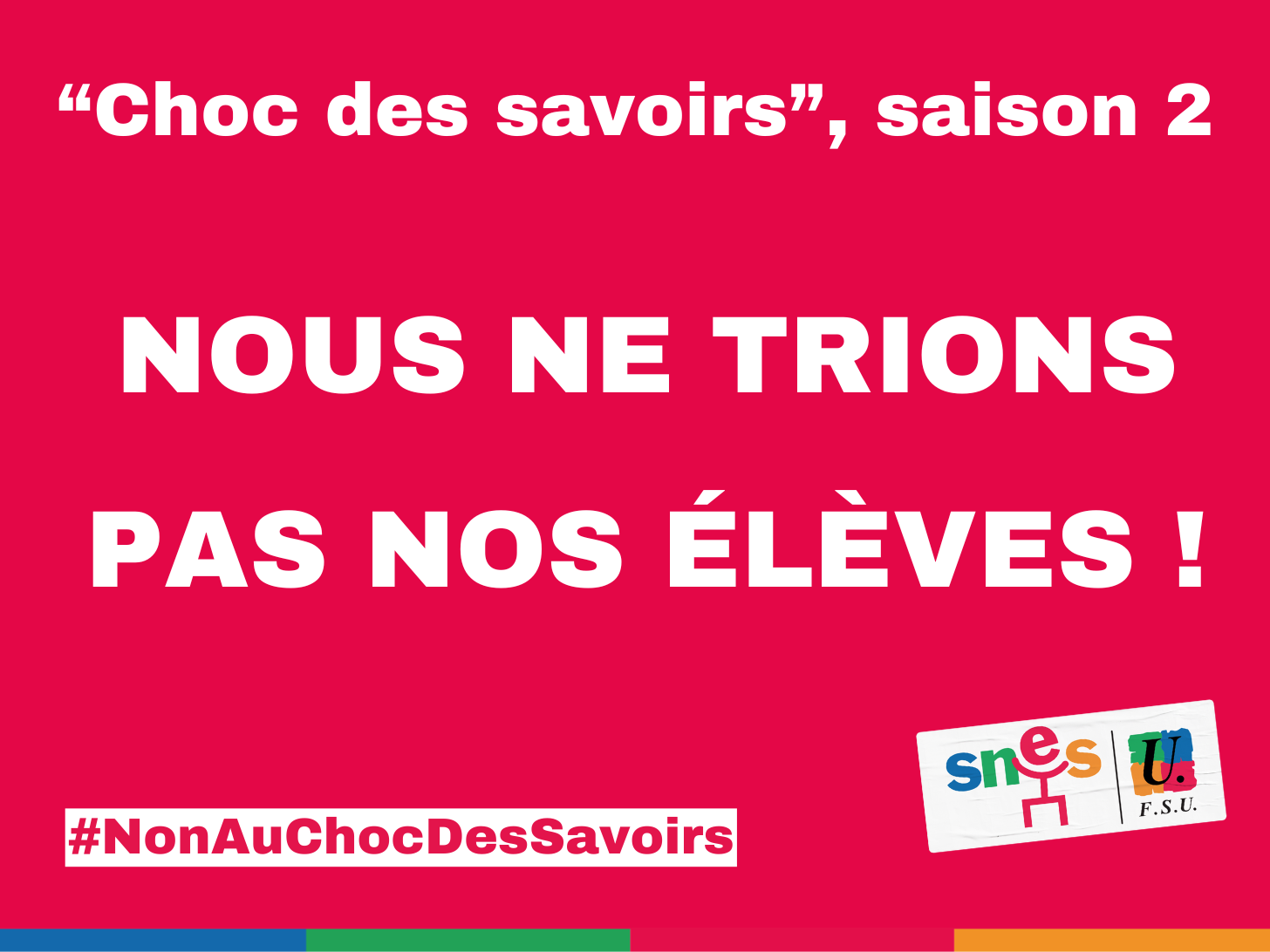
 Élections professionnelles :
Élections professionnelles :